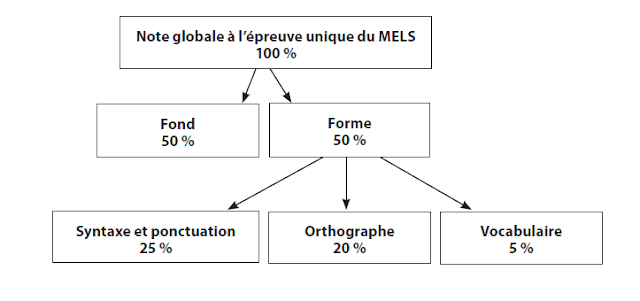Wikipedia crédite le
linguiste Lionel Meney d’avoir introduit dans le débat linguistique au Québec
le terme d’endogénisme. Voici ce qu’en dit cette encyclopédie :
Au
Québec, l'endogénisme est une conception linguistique qui consiste à
privilégier et à promouvoir une norme linguistique nationale québécoise, le
français québécois standard, plutôt qu’une norme linguistique partagée par
plusieurs nations francophones, le français standard international. Les
partisans de l’endogénisme linguistique, ou endogénistes, considèrent que le
français des grammaires et des dictionnaires de référence, comme Le Bon
Usage de Maurice Grevisse, le Petit Larousse illustré ou le Nouveau
Petit Robert, décrivent un modèle linguistique étranger, une norme exogène,
en fait le français de la bourgeoisie parisienne.
L’attention des endogénistes
s’est focalisée sur le vocabulaire et en particulier sur la nécessité de
publier un dictionnaire propre au français du Québec. Ce qui est une vision
réductrice de la langue : une langue, ce n’est pas uniquement ce qui se
trouve dans un dictionnaire. Une langue est d’abord parlée. La description
des traits de prononciation du français québécois est largement acquise. Déjà
en 1969 Jean-Denis Gendron déclarait qu’« il est en train de s'établir ce qui
n'avait jamais existé ici, une norme de prononciation ».
Mais personne n’a jamais fait l’effort de proposer, en premier lieu aux
enseignants, un modèle de prononciation qui facilite l’intercompréhension avec
les autres francophones, qui serve de référence, qui devienne leur variété de
langue et qui soit la norme que l’on enseigne aux élèves. Mentionnons toutefois
le dictionnaire en ligne Usito qui base sa description phonétique sur « la
prononciation du français québécois standard telle qu’on peut l’observer dans
les manifestations officielles de la parole publique, essentiellement dans les
émissions d’information et d’affaires publiques des réseaux publics (non
commerciaux) de radio et de télévision ».
De même la grammaire du
français québécois n’a guère retenu l’attention des linguistes à l’exception de
Jean-Marcel Léard (Grammaire québécoise d’aujourd’hui. Comprendre les
québécismes, Montréal, Guérin Universitaire, 1995). C’est ainsi que la
manière québécoise d’énoncer une condition en se servant de l’infinitif,
surtout celui du verbe savoir (savoir qu’il viendrait…, avoir su qu’elle
viendrait…) n’est même pas mentionnée dans Usito alors qu’on la trouve dans
des œuvres littéraires.
Puisque la préoccupation
première des endogénistes a été le lexique, voyons un peu le résultat de leurs
efforts.
Dicos sous
respirateur
Au début, avant même que
naisse l’idéologie endogéniste, il y a eu le Dictionnaire général de la
langue française de Louis-Alexandre Bélisle dont la première édition
complète et reliée est parue en 1957. L’ouvrage a été vivement critiqué par des
linguistes. Mépris de classe ? L’auteur était autodidacte et son œuvre vendue
en fascicules dans les supermarchés... Son dictionnaire était « adapté »,
c’est-à-dire fait à partir d’un dictionnaire publié en France (le Littré).
Signalons le Dictionnaire
de la langue québécoise (1980) de Léandre Bergeron, fortement critiqué dès
sa parution pour son caractère joualisant et dont la nomenclature ne comprenait
guère que des québécismes. Ce n’était donc pas un dictionnaire général.
Dans la lignée des
dictionnaires « adaptés » il y eut le Dictionnaire du français
Plus à l’usage des francophones d’Amérique (1988), basé sur un dictionnaire
Hachette, et le Dictionnaire québécois d’aujourd’hui (1992, 1993), basé
sur le Micro-Robert Plus. Ces deux derniers dictionnaires, qui ont connu
un « échec commercial » (Lockerbie,
2003 : 146), avaient pris le parti de ne pas identifier
les québécismes, mais à l’inverse de signaler par la marque France les
emplois propres au français de France. Leurs auteurs se déclaraient résolument
en faveur d’une norme québécoise.
Les rédacteurs d’Usito ont
voulu prendre le contre-pied des dictionnaires « adaptés » et
produire un dictionnaire totalement conçu et rédigé au Québec. Mais il y a loin
de la coupe aux lèvres ainsi que l’ont démontré Claude Poirier, ancien
directeur du Trésor de la langue française au Québec, et Lionel Meney. Citons
ce dernier :
[…] on peut affirmer qu'Usito est un échec.
Contrairement à ce qui avait été prévu et annoncé, ce n'est pas un dictionnaire
général et complet du français québécois. Il n'est pas fondé sur la seule base
d'un corpus de textes québécois. Il utilise massivement le Trésor de la
langue française (TLF), le grand dictionnaire français en 16 volumes (plus
supplément) produit à Nancy. Reprenant l'architecture et les termes de ce
dictionnaire, tronquant les citations d'auteurs français pour en extraire des
syntagmes (groupes de mots, locutions, expressions), il n'a pas réussi à
traiter correctement les québécismes. Il plaque artificiellement les uns,
considérés comme « corrects », dans le corps des articles recopiés du
TLF. Il relègue les autres, considérés comme « incorrects »,
dans une rubrique spéciale hors article. Plutôt qu'un dictionnaire général du
français québécois, Usito est un dictionnaire hybride, produit en France
pour la partie français international, au Québec pour la partie québécismes (étonnamment,
cette partie est très lacunaire).
Cinq ouvrages se distinguent
des précédents.
Le Multidictionnaire de
la langue française de Marie-Éva de Villers (Montréal, Québec Amérique, 1re édition,
1988; 7e édition, 2021) est un succès de librairie. Ce
dictionnaire de difficultés s’est imposé dans les bureaux et dans
l’enseignement.
Le Visuel d’Ariane
Archambault et Jean-Claude Corbeil, décliné en plusieurs versions (bilingue,
multilingue, junior, mini), est un autre succès de librairie (traduit en 26
langues, plus de six millions d’exemplaires vendus depuis 1982). Il a ceci de
particulier qu’il ne comporte aucune définition.
Le Dictionnaire québécois
français (Montréal, Guérin, 1999; 2e édition, 2003) de
Lionel Meney a la particularité d’être « bivariétal ». Contrairement à ce que faisaient les glossaires, il donne, en situation de communication identique, les
équivalents exacts en français de France de mots québécois.
Le Grand Dictionnaire
terminologique (GDT) de l’Office québécois de la langue française (OQLF) a été
conçu à l’origine comme un outil d’aide à la francisation des entreprises. Il
devait s’intéresser aux registres de la langue technique courante ou soutenue.
Plutôt que d’orienter l’usage il en est venu, depuis une vingtaine d’années, à
décrire et légitimer les emplois de registre familier : les linguistes Jean-Claude
Corbeil et Marie-Éva de Villers ont parlé d’« un détournement de la
mission de l’OQLF » (Le Devoir, 27 septembre 2017). Cette réorientation
est la conséquence de l’arrivée à l’OQLF de personnes qui ont dû quitter le
Trésor de la langue française au Québec (TLFQ) par suite d’un manque de
subventions après une période de vaches grasses, les années 1970-1990
(cf. Meney, 2017).
Œuvre du TLFQ, le Dictionnaire
historique du français québécois (1998) ne porte que sur les québécismes. La
première édition ne contenait que 651 articles (ou monographies). À l’origine,
on prévoyait la publication d’« une dizaine de tomes échelonnés sur une
vingtaine d’années » (Le Soleil, 13 avril 1985). Ce n’est qu’en
2023 qu’une deuxième édition a été mise en ligne. Il est difficile de mesurer l’importance
des nouveautés. Un copier-coller dans le le tableur Excel de la liste des entrées donne un total
supérieur à 800. Soyons généreux et admettons que la version en ligne compte
200 entrées de plus. Il y a des monographies courtes (cocoa, tv-dinner, zucchini…)
et d’autres dont on peut douter qu’elles traitent de québécismes (ketchup, wok…).
« Le DHFQ est réalisé grâce à l'appui financier du gouvernement du Québec,
par l'intermédiaire du ministère de la Langue française. »
À la suite des échecs
commerciaux des dictionnaires généraux prétendant décrire le français au Québec,
aucun éditeur ne s’est aventuré à entreprendre la publication d’un dictionnaire
« de langue ». Les éditeurs ne sont prêts à investir que dans des créneaux
bien spécifiques (Visuel, Multidictionnaire, Dictionnaire québécois français).
C’est pourquoi les endogénistes ont sollicité l’aide de l’État. Les dictionnaires endogénistes Usito et DHFQ — auxquels
il faut désormais ajouter le GDT — ne subsistent que par l’aide de l’État :
ils sont sous perfusion. Dans une société régie par la main invisible
d’Adam Smith, ces « produits dictionnairiques » n’existeraient pas.
Une base démographique
qui s’effrite
Dans les années 1970, beaucoup
d’attention a été portée à la description du français populaire de Montréal, en
particulier la langue du quartier populaire Centre-Sud. Ces travaux ont été
publiés par l’Office de la langue française (La syntaxe comparée du français
standard et populaire : approches formelle et fonctionnelle, 1982, 2 tomes).
Ce qui a suscité l’ire de l’éditorialiste du Devoir Lise Bissonnette qui
a reproché à l’Office de publier une grammaire du joual. Aujourd’hui le
Centre-Sud est en pleine gentrification.
Des traits propres au parler des classes populaires de Montréal sont en net
recul depuis plusieurs années (le r roulé, la prononciation de mots
comme garâge…). Mais la nouvelle donne démographique pourrait non
seulement continuer de marginaliser le parler des classes populaires, elle
pourrait aussi changer le caractère général du français parlé à Montréal (si
tant est qu’il réussisse à se maintenir face à l’anglais). Montréal étant la
capitale culturelle, en particulier par la concentration des médias, les
changements qui s’y produisent finissent tôt ou tard par influencer la langue
de tous les Québécois.
Dans le dernier Portrait socioculturel des élèves inscrits dans les écoles publiques de
l’île de Montréal on apprend que 56 % de la totalité des
élèves sont soit nés à l’étranger, soit nés ici de deux parents étrangers. Dans
38 % des écoles publiques, primaires ou secondaires, plus des deux tiers
des élèves sont de ces catégories ; 25 % en accueillent 75 % ou
plus ; 10 % en accueillent 85 % ou plus. C’est Jean-François
Lisée qui a attiré mon attention sur ces données.
On se demande comment les jeunes Québécois « d’ascendance
canadienne-française » devenus minoritaires dans les écoles pourront
imposer leur façon de parler. Pourront-ils même plus généralement imposer le
français ? Ne commencent-ils pas déjà à passer à l’anglais ?
Mais Lisée dépasse le
problème de la langue quand il pose la question : « Comment penser
qu’une immigration importante provenant de pays où la culture locale est
immensément moins tolérante, et fondée sur le dogme religieux, pourrait
s’insérer dans notre vision des choses sans qu’on en sente des effets
concrets ? »
Références
Lockerbie, Ian (2003),
« Le Québec au centre et à la périphérie de la francophonie », Globe 6/1,
125-149.
Meney, Lionel (2017), Le
Français québécois entre réalité et idéologie. Un autre regard sur la langue,
Presses de l’Université Laval.